Vous le ressentez sans doute tous.
Le problème, ou plus précisément le risque majeur, ce n’est pas juste la fronde ou la jacquerie agricole en cours aussi légitime soit-elle.
C’est la convergence des luttes et surtout des mécontentements.
La révolte des Gilets Jaunes n’a jamais trouvé de solution politique. Elle a été écrasé par la répression d’un Etat qui a instrumentalisé la police devenant milice dès qu’il y a confusion entre maintien de l’ordre et maintien au pouvoir. La police est au service de la population. Pas d’un gouvernement bien mal choisi par un président fort mal élu à la popularité douteuse depuis le départ.
Un climat révolutionnaire
Le gouvernement sait donc très bien qu’il marche sur des œufs.
De l’inflation quotidienne à la hausse injustifiée de l’électricité devenue un produit de première nécessité pour toutes les familles de ce pays, des difficultés d’emplois aux problèmes quotidiens, de l’effondrement du système de santé à notre école, et je n’ose même pas évoquer les problèmes de violences quotidiennes dans notre pays, la cote d’alerte a été dépassée il y a bien longtemps.
Notre pays est un volcan qui peut rentrer en éruption à la moindres étincelles.
Routiers comme chauffeurs de taxis sont déjà par endroits rentrés dans le mouvement.
Partout les blocages se multiplient.
Enfin, et c’est également très important à saisir pour anticiper la manière dont ce mouvement pourrait évoluer, il y a dans notre pays une immense démission.
Cette démission massive des gens est silencieuse.
J’ai évoqué rapidement ce que j’ai vu pendant l’épisode neigeux que nous venons de vivre.
5 centimètres de neige qui ne bloquaient pas les voitures sans chaînes des managers et autres entrepreneurs ou dirigeants, mais qui empêchaient toutes les voitures des salariés plus très engagés (et c’est un euphémisme) de rouler pendant deux jours.
J’ai vu des écoles désertées aussi bien par les profs que par les élèves.
J’ai vu des lycées et des collèges vides, y compris de ceux qui pouvaient venir à pieds.
J’ai vu la France rester au chaud et ne plus faire le moindre effort.
Lorsque je vous parle de cela je ne suis pas dans une forme de jugement.
Je constate et je pose un mot. La grande démission.
Je pose un autre mot.
L’effondrement de la croyance imaginaire dans la république.
C’est la fin de la fiction imaginaire.
Ce que nous vivons c’est la Russie de Gorbatchev. L’illusion de la force, alors que le colosse va s’effondrer.
Notre pays va s’effondrer car plus personne n’y croit.
Si le grogne est réprimée, alors la colère rentrée s’exprimera par encore plus de démission silencieuse et plus rien ne fonctionnera plus.
Macron est un imbécile et sa clique aussi.
On ne dirige pas un pays à coups de triques et de flash-ball.
On ne dirige pas un pays à coups de communication et de manipulations médiatiques.
On ne dirige pas un pays contre son peuple avec des auto-attestations et des passes sanitaires et autre QR codes .
Macron est un imbécile politique, car ce qu’il a fait peut donner l’illusion du maintien au pouvoir.
Mais Macron ne dirige plus rien en réalité.
Vous savez pourquoi ?
Parce que dans la vraie vie, sur le terrain, partout, ce pays est en grève.
En grève silencieuse.
En grève du zèle.
Mais en grève quand même.
Dans tous les cas Macron et sa clique ont déjà perdu, mais plus grave encore, la France a perdu, car la France a cessé de travailler, de rêver, d’avoir envie de construire un monde meilleur.
Si la France est en grève, la raison est simple à comprendre.
On ne gouverne pas contre la population mais avec elle.
Personne ne veut de la politique imposée par Macron, son europe, et ses copains de Davos.
Personne ne veut voir ses fils mourir pour Zelenski.
Je suis un homme simple.
Remplir les gamelles et assurer la paix.
Pour cela il nous faut notre souveraineté et un gouvernement qui protège notre population.
Notre population des villes, des banlieues et des campagnes.
Macron est un homme de Davos, en aucun cas un président des Français qu’il n’a jamais aimés, n’aimera jamais.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !
Charles SANNAT
Il y a deux Occident : l'Occident mondialiste et l'Occident... ordinaire. Les mondialistes représentent l'Occident 1. Ce faisant, ils refusent de reconnaître qu'il n'y a personne d'autre qu'eux dans le monde. Ils insistent donc sur le fait qu'il n'y a pas de "deuxième" Occident, d'Occident-2. Mais il y en a un.
Nous, le monde multipolaire, devons reconnaître aussi clairement que possible l'existence de cet Occident-2.
Il se compose d'une variété de forces qui ne sont pas d'accord avec l'agenda mondialiste ultra-libéral des élites.
Il y a les gens de gauche, comme Sarah Wagenknecht et son nouveau parti. La "Sarah rouge" (une Valkyrie de double origine, iranienne et allemande) est en train de devenir le symbole de la gauche illibérale en Europe.
En Italie, Diego Fusaro, disciple du marxiste et antimondialiste Costanzo Preve, est un théoricien de la même tendance.
En France, nous avons Alain Soral, ainsi que Michel Onfray, Jean-Claude Michéa et Serge Latouche.
Ces hommes et femmes de gauche sont avant tout des ennemis du capital mondial. Ils se distinguent de la pseudo-gauche achetée par Soros : cette dernière est avant tout en faveur des LGBT, du nazisme ukrainien, du génocide de Gaza et des migrations incontrôlées, mais contre la Russie et ce que leurs maîtres capitalistes, eux-mêmes nazis libéraux, appelleraient le "fascisme".
Il y a aussi une composante de droite - mal en point, mais qui, dans de nombreux pays européens, représente la deuxième force politique la plus importante. Par exemple, Marine Le Pen en France.
En Allemagne, Alternative pour l'Allemagne et d'autres mouvements plus modestes gagnent en puissance. En particulier en Prusse (ex-RDA).
En Italie, malgré l'infirmité libérale de Meloni, la moitié droite de la société n'a pas progressé.
Et tout le populisme de droite n'a pas progressé non plus.
Mais à l'Ouest 2, ce sont surtout les gens ordinaires qui se dressent, ceux qui ne comprennent rien à la politique. Ils ne peuvent tout simplement pas suivre les demandes de changement de sexe, de castration forcée de leurs petits fils, de mariage avec des chèvres, d'arrivée et d'entretien d'un plus grand nombre d'immigrés et de maniaques ukrainiens sauvages, incapables d'une hygiène de base et de soins personnels, de manger des cafards, de réciter des prières telles celles de Greta Thunberg à l'heure du coucher et de maudire les Russes, qui ne leur ont rien fait de mal. L'homme ordinaire occidental, la petite bourgeoisie, est le pilier du soulèvement à venir. Cet homme ordinaire ne comprend plus les élites libérales. Il est irrémédiablement opposé à l'accélération de la dégénérescence et de l'avilissement que ces élites exigent de lui.
Entretien.
Les canalisations sont attaquées à la disqueuse, la CGT Énergie coupe le jus à des élus soutenant la réforme des retraites, des antennes 5G crament un peu partout, 200 activistes équipés de pinces-monseigneur font le ménage dans une cimenterie Lafarge et des mégabassines sont lacérées à coups de cutter. Autant d’actions constituant de bonnes raisons d’aborder l’histoire du sabotage avec Victor Cachard, auteur de plusieurs ouvrages récents sur le sujet. Un entretien mené en terrasse d’un café lyonnais au nom bien à propos : le Court-circuit.
CQFD : Dans les cortèges contre la réforme des retraites, la foule scande souvent le triptyque « Grève, blocage, sabotage ». Longtemps mise de côté, la pratique du sabotage comme outil de lutte retrouve-t-elle du souffle ?
Couverture du tome 1 du livre Histoire du sabotage
Victor Cachard, Histoire du sabotage : tome 1 « Des traîne-savate aux briseurs de machines, Éditions Libre, 2022 ; tome 2 « Neutraliser le système techno-industriel », même éditeur, à paraître.
Oui, et c’est tant mieux, mais le terme de sabotage fait encore peur. Il a pris une connotation guerrière avec la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans la mémoire collective, il est associé au dynamitage des voies de chemin de fer, ou à l’idée d’attaque discrète, de coup dans le dos, un peu lâche…
Pourtant, le sabotage occupe une place importante dans l’histoire des luttes et il a été massivement utilisé par les travailleurs dès la fin du 19e siècle. On le sait peu, mais à la fin de son troisième congrès en 1897, la CGT l’a adopté officiellement comme tactique syndicale sous l’impulsion des anarchistes. Ce mode d’action, tout comme la grève générale, est aux fondements de la lutte syndicale !
Émile Pouget, révolutionnaire dont vous avez publié une anthologie [1], dit que le sabotage est vieux comme l’exploitation des travailleurs…
Il a été pratiqué bien avant d’être théorisé comme tactique de lutte. De tout temps, les exploités ont pu, de façon isolée, ralentir la cadence face à des exigences insupportables, ou produire volontairement et discrètement un mauvais travail. Contrairement à ce que l’on croit, le sabotage ne renvoie pas à la chaussure en bois (sabot) qui serait jetée dans la machine. C’est le nom donné au 13e siècle à une petite toupie en bois qui, quand elle tourne, donne l’impression d’être immobile. Comme le travailleur qui fait semblant de faire du bon ouvrage. « À mauvaise paie, mauvais travail », disaient les Anglais. Le sabotage est d’abord une attitude défensive, directement liée au travail. C’est finalement sous l’impulsion des syndicalistes révolutionnaires français que le terme gagne son caractère offensif.
Totalement absente des médias français, éclipsée par l'actualité d'une métropole en ébullition face aux coups de matraques d'un pouvoir contre son peuple, reléguée derrière une propagande d'une échelle inédite jusqu'alors visant à maintenir l'illusion d'une victoire à venir de l'Ukraine et de l'OTAN, la révolution diplomatique conduite par la Chine au Moyen-Orient marque l'aurore d'une nouvelle ère qui verra probablement le refoulement de l'influence nuisible de Washington hors d'une région et loin des peuples dont le martyre infligé par l'occident colonial depuis trois-quarts de siècle a suffisamment duré.
Si ce terme renvoie à la Pax Romana et à la Pax Americana, toute ressemblance s’arrête là, ces deux derniers termes impliquant des contextes radicalement différents de la situation chinoise : des empires étendus bien au-delà de leurs frontières directes et l’imposition de la paix par la soldatesque. Dans l’histoire de la Chine, les dynasties Han, Tang et Ming sont des empires qui sont globalement limités à l’intérieur des frontières actuelles du territoire chinois. Elles représentent des ères historiques et des aires géographiques de développement humain sans précédent, que ce soit en terme de progrès techniques, d’échanges commerciaux et culturels et d’explorations maritimes.
En 1949, au sortir de la guerre et de l’occupation japonaise, d’un siècle et demie de conflits internes, de pillages coloniaux et de déclin politique qui l’auront maintenu hors de portée de la révolution industrielle, la Chine est parmi les pays les plus pauvres du monde. En soixante-quinze ans, elle se hissera pourtant au rang des trois premières puissances mondiales tout en demeurant jusque là, aussi insolite que ce soit pour des observateurs habitués à une arrogance toute occidentale, dans une relative discrétion sur le plan diplomatique, peut-être par l’entremise d’un cocktail d’humilité et de patience. De cette patience nécessaire face à un fauve mourant, toujours capable de coups mortels dans son agonie.
C’est le 7 septembre 2013 que pour la première fois, Xi Jinping fait mention de ce projet, baptisé 一带一路 (yī dài yī lù, une ceinture, une route en français), renommé plus tard Belt And Road Initiative (BRI) ou la Nouvelle Route de la Soie, en référence à l’ancienne route commerciale sous la dynastie Han. Lors de ce discours prononcé à l’université Nazarbaïev d’Astana au Kazakhstan, Xi en trace les contours et surtout énumère ses principes : « partager la paix et le développement tant qu’ils persistent dans l’unité et la confiance mutuelle, l’égalité et les avantages mutuels, la tolérance et l’apprentissage les uns des autres, ainsi que la coopération et les résultats gagnant-gagnant », « faire avancer le développement et la prospérité communs, et travailler pour le bonheur et le bien-être des peuples des pays de la région ». La BRI vise à mettre toute l’Eurasie, mais aussi l’Afrique, le Moyen-Orient et le sud-est asiatique à portée de la Chine et vice-versa, par voie ferrée et maritime. Près de mille milliards de dollars ont été investis par la Chine le long des Nouvelles routes de la soie à des fins de modernisation des infrastructures dans le cadre de la stratégie gagnant-gagnant qui a fait la marque de fabrique d’une diplomatie chinoise du progrès et du développement, notamment sur le continent africain. Non seulement, on ne compte plus la myriade de projets coopératifs entre la Chine et ses partenaires mis en place depuis le démarrage de ce chantier pharaonique, mais il a également favorisé la coopération entre nations voisines, faisant ainsi pendant à la conflictualité, à l’accaparement et à l’esprit de division propre à l’impérialisme américano-occidental dominant le monde depuis l’après-guerre.
UE et EU : les deux faces d’une même pièce
S’excluant de facto de ce projet, les États-Unis le perçoivent comme une volonté hégémonique chinoise (l’hôpital et la charité) et chez leurs alliés ouest-européens, on le considère soit avec indifférence soit avec une circonspection teintée de la crainte de déplaire à la Maison Blanche, à l’instar de la France ou plus récemment de l’Italie qui s’est fait taper sur les doigts après avoir montré un enthousiasme trop poussé pour la BRI et qui depuis l’élection de Meloni envisage son retrait, malgré des accords signés.
Dissimulant mal les caprices infantiles d’une institution plus zélée à se soumettre aux desiderata de Washington qu’à agir dans l’intérêt de ses peuples, l’UE crée un contre-projet et l’illusion qu’elle maîtrise encore quelque chose. En réalité, elle a un mal fou à ne pas sombrer : la déstabilisation de l’Europe centrale et la rupture de ses liens commerciaux avec la Russie orchestrés outre-Atlantique sont autant de manoeuvres qui cherchent à l’affaiblir tout en mettant des obstacles le long de la BRI.
Des obstacles que la Chine, patiemment, écarte du passage.
À Polytechnique, dans l’Essonne, durant la cérémonie du 24 juin 2022, plusieurs diplômé·es invitent étudiant·es et anciens à « amorcer un virage radical » et à « construire un avenir différent de celui qui semble tout tracé aujourd’hui ».
« Il est urgent de sortir des rails sur lesquels nous installent insidieusement notre diplôme et notre réseau. Car tenter de résoudre à la marge des problèmes sans jamais remettre en cause les postulats mêmes du système dans lequel nous vivons ne suffira pas », expliquaient les diplômé·es de la plus prestigieuse des écoles d’ingénieurs françaises.
« On ne croit pas qu’on va changer les grandes entreprises de l’intérieur », résume Johanna. Car le profit fait partie de l’ADN de l’entreprise. » « Nous espérions - ne serait-ce qu’un peu - détourner, réformer, humaniser nos industries, nos employeurs, nos postes. En vain », écrivent également les auteurs et autrice du manifeste « Vous n’êtes pas seul·es ».
Les trois fondateurs de ce collectif – Jérémy Désir, cadre chez HSBC en finance de marché, Mathilde Wateau en logistique humanitaire au Programme alimentaire mondial, et Romain Boucher en big data – ont démissionné publiquement afin de lancer l’alerte sur les nuisances de leur secteur respectif.
Le ton fataliste a laissé place à un souffle d’espoir. Alors que l’auteur affirmait initialement que « la transition est morte » et l’« utopie bornée », son nouvel ouvrage invite de manière « vitale » à la « révolution »à travers une « utopie éclairée ».
« Il nous faut absolument tout repenser, requestionner, tout déconstruire, déconditionner. Transition ? Non, RÉVOLUTION ! »
Le Dr Louis Fouché, médecin particulièrement critique de la crise sanitaire revient sur l’ensemble des sujets qui tournent autour de la situation actuelle et de la société du futur. Derrière une posture affichée un peu zen, mi-désabusée, mi-peace and love, Louis Fouché porte en lui une véritable et noble force d'insurrection.
« On a souvent besoin d’un grand méchant loup, d’un ennemi parce que ça permet de structurer un « nous ». Regardez, aujourd’hui l’ennemi c’est tous les gens qui ne pensent pas directement dans le néolibéralisme et dans le transhumanisme, c’est-à-dire que tous ceux qui veulent ralentir, revenir à la nature, revenir à un monde réel et pas fantasmé, numérique, en fait ils sont dangereux, qu’ils soient marxistes, communistes, crypto-marxistes, alternatifs, qu’ils soient dans des ZAD, qu’ils soient anarchistes, qu’ils soient conspirationnistes, rassuristes, complotistes, qu’ils aient discuté avec Dieudonné ou Soral, tout le monde à la fin est étiqueté d’extrême droite. C’est juste la fabrique de l’ennemi, parce que ça permet de se sentir bien entre soi. »
Dans cet article, retrouvez des acteurs au cœur de la révolution En Marche !
« La calomnie est en politique moins gênante que la manifestation de la vérité. »
Le sociologue nous a reçu chez lui pour un entretien chaleureux dont les conclusions sont glaçantes. Selon lui, les soulèvements vont être violents, vont contester l’ordre vertical imposé par la caste. Et ils feront couler le sang.
« C’est donc à ceux qui gouvernent la cité, si vraiment on veut l’accorder à certains, que revient la possibilité de mentir »
Un article initialement publié sur Health Impact News le 8 juin 2020. Cette « remise à plat » de l'économie mondiale comprendra le passage à la monnaie numérique et la suppression des espèces, une redistribution des richesses et la réduction de la taille de la population mondiale pour « lutter contre le réchauffement climatique » et inaugurer le Nouvel ordre mondial. Elle comprend également le lancement de la Quatrième révolution industrielle, le « transhumanisme ». Qui vise à intégrer les ordinateurs et l'intelligence artificielle aux êtres humains.
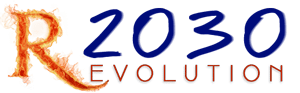

 Ca va péter. Vers une convergence des luttes ?
Ca va péter. Vers une convergence des luttes ?
 Alexandre Douguine : 2024, vers une révolution européenne ?
Alexandre Douguine : 2024, vers une révolution européenne ?
 De la Guerre civile en France, et du combat pour sa libération
De la Guerre civile en France, et du combat pour sa libération
 Faire planer la possibilité du sabotage est une force
Faire planer la possibilité du sabotage est une force
 Pax Sinica
Pax Sinica
 RÉVEILLONS-NOUS
RÉVEILLONS-NOUS

 Un souffle d’espoir face aux effondrements
Un souffle d’espoir face aux effondrements
 Dr Louis Fouché : « Il faut rester ouvert et en lien avec le monde »
Dr Louis Fouché : « Il faut rester ouvert et en lien avec le monde »
 La dictature macroniste tremble ! Retour sur les manifestations du 17 juillet
La dictature macroniste tremble ! Retour sur les manifestations du 17 juillet
 Maffesoli et l'ère des soulèvements
Maffesoli et l'ère des soulèvements
 Le « Grand Reset du Monde », le transhumanisme et la 4e révolution industrielle
Le « Grand Reset du Monde », le transhumanisme et la 4e révolution industrielle