De nombreuses lois visant à combattre la désinformation et la mésinformation sont en cours d’adoption dans les pays occidentaux, à l’exception partielle des États-Unis, où le premier amendement est en vigueur. Cette situation a conduit à la mise en œuvre de méthodes de censure plus discrètes.
Une réponse inattendue à ces lois restrictives pourrait provenir de la critique littéraire. Les termes utilisés, tels que les préfixes ajoutés au mot « information », sont trompeurs. L’information, qu’elle soit contenue dans un livre, un article ou autre, demeure un artefact passif. Elle ne peut agir par elle-même, et donc, elle ne peut enfreindre aucune loi. Les nazis ont peut-être brûlé des livres, mais ils ne les ont pas arrêtés ni emprisonnés. Ainsi, lorsque les législateurs cherchent à interdire la « désinformation », ils ne peuvent pas viser l’information en tant que telle, mais plutôt la création de sens.
Les autorités emploient des variantes du terme « information » pour insinuer qu’il s’agit de vérités objectives, mais ce n’est pas le cœur du problème. Ces lois, par exemple, s’appliquent-elles aux prévisions des économistes ou des analystes financiers, qui font régulièrement des prédictions erronées ? Bien sûr que non. Pourtant, des prévisions économiques ou financières crédibles pourraient avoir un impact significatif sur les populations.
Ces lois sont davantage conçues pour cibler l’intention des auteurs, visant à créer des significations non conformes à la position officielle du gouvernement. La « désinformation » est généralement définie dans les dictionnaires comme une information intentionnellement trompeuse et préjudiciable. En revanche, la « malinformation » implique la diffusion de faits véridiques, mais avec une intention malveillante. La détermination de l’intention de l’auteur est souvent cruciale dans ces cas.
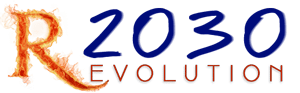

 La guerre mondiale contre le crime de pensée
La guerre mondiale contre le crime de pensée