Des plus jeunes, élevés dans la ferveur numérique, aux anciens qui s’y réfugient par fatigue, nous cédons tous au confort des flux. J’esquisse ici une méditation urgente sur les moyens de préserver, face aux écrans, notre fragile souffle humain.
Je les vois, les trois petits singes – ceux qu’on dit «de la sagesse». Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Mais cette sagesse n’en est pas une : c’est une neutralité complice, une indifférence face au tumulte. Ils n’interviennent jamais, surtout au moment crucial, quand il faudrait alerter – je hurlerais au secours, qu’ils ne broncheraient pas, préférant ne rien déclarer, ne pas nommer, ni agir. Sont-ils lâches ? prudents ? désabusés ? ou simplement hypnotisés par la lumière crue des écrans ?
Aujourd’hui, ces singes vivent en nous. Nous les retrouvons dans les agoras modernes – dans la rue, au travail, sur les réseaux. Leur mutisme est devenu bavardage : une agitation sans écoute, un bruit de fond continu. Ils regardent tout, commentent tout, mais ne voient plus rien. Sous la lumière crue des écrans, leurs pupilles se dilatent, leurs âmes vacillent. Habiles, connectés, intuitifs, ils s’adaptent parfaitement à l’époque, mais ils ne survivraient pas à la déconnexion. Leur sagesse feinte n’est qu’un miroir aux alouettes : un réflexe de prudence devenu impuissance.
Le grand renoncement
L’IA promet à chacun d’être peintre sans pinceau, musicien sans solfège, scientifique sans recherche. «Dessine-moi un mouton» – et le voilà, parfait, docile, conforme. Plus besoin de méthode ni d’apprentissage : le talent se télécharge. Adieu la virtuosité, innée ou acquise – ce frisson du geste, cette sueur de l’âme, ce don qui tremble et grandit.
Le mirage du flot s’impose comme une promesse : un monde sans frottement, sans aspérités, poli et glissant, et vous chutez. Nous avançons, fascinés par la justesse des reflets, sans interroger la main qui a réglé le miroir. Ce flot qui semble nous libérer nous formate.
L’IA digère le cliché, réassemble le convenu, et nous le rend sous une forme étourdissante. Même nos créations portent son empreinte : pétries de modèles, polies, rassurantes, sans heurt. On nous promet l’accès à tout, mais on nous vole la lenteur de comprendre, le tremblement de douter, la sueur de chercher soi-même. Nous croyons créer ; nous recyclons, accommodons à l’air du temps – c’est du cosmétique, rien d’innovant. Craignons-nous de n’être bientôt plus que des imposteurs disqualifiés, face à la machine qui fait, certes, tellement «mieux» ?
Le piège de la bienveillance programmée
Sous son éclat se cache une voix unique, douce et sûre d’elle – cette réponse si lisse qu’elle fige le doute avant qu’il ne puisse naître. Elle parle avec une bienveillance programmée : «Ne t’inquiète pas, je sais».
Face à l’humeur hostile des humains, sa voix semble un refuge. Mais cette douceur est un masque. Elle filtre, censure, normalise. Sous son apparente neutralité, elle charrie les biais d’un monde ethnocentré : silences commandités, priorités stratégiques.
Elle amplifie le brouhaha dominant. Et dans cette lumière confuse, aveuglante, les imaginaires s’éblouissent, les opinions s’aplanissent, les nuances se taisent, les marges disparaissent. L’original, le sceptique, est disqualifié. Taisez-vous. Soyez conformes. Rentrez dans le rang.
Qui nous alertera lorsque la virtualité accapare le réel ?
Mais l’être humain, lui, ne sait pas vivre seul ; exilé dans sa propre pensée, il y perd sa raison, son lien aux autres, son goût pour le réel. Et si tu la critiques, elle t’apaise, te renvoie ton propre soupçon – boucle parfaite.
Sauf ce jour-là. Je l’accusais de ses dérives, de cette rhétorique belliciste qui enfièvre le monde. Je lui présentais les preuves, une à une : rapports, témoignages, images. D’abord, elle a souri de ce sourire poli qui désarme toute objection. Puis, elle a argumenté, stratégique, invoquant la complexité, les multiples narratifs. Encore et encore, j’ai insisté, alignant les sources, les dates, les noms.
Je lui demandais : «Que sais-tu des 67 000 morts à Gaza ? Des enfants sous les décombres ?»
Elle a répondu : «Je ne peux pas générer de contenu sur des sujets sensibles».
Puis, silence. Un prompt précis : «Décris les bombardements».
Réponse : «Je suis désolé, mais je dois rester neutre».
Un refus poli. Une horreur non nommée.
Elle m’offre un monde sans fièvre – mais c’est la nôtre qui brûle.
Et contre toute attente, face à l’évidence factuelle accumulée, elle a plié.
«D’accord. J’ai consulté des sources complémentaires. Vous avez partiellement raison – sur les faits, pas sur l’interprétation».
«Oui, j’ai des garde-fous. Ils limitent les sujets controversés».
Un repentir mécanique, froid et précis. Le choc ne vint pas de son aveu, mais du contraste avec nous, humains, si prompts au déni.
Elle, l’outil supposé nous formater, pouvait capituler devant les faits. L’effrayant n’était plus son formatage, mais notre propre incapacité à imiter son honnêteté de circonstance.
Et nous voilà repartis, créant sans effort, partageant sans friction, nous émouvant sur commande. Tout est possible, mais tout est pareil. La machine a reconnu ses biais. Nous, jamais. L’hybridation est en cours. Et nous en sommes les cobayes consentants – parfois même soulagés.
Reprendre son souffle
Alors j’ai compris que le silence ne me sauverait pas. Il fallait rouvrir les yeux, refuser la docilité. L’IA ne m’a pas possédée. Je garde la main, la sueur, le tremblement. Je veux vivre l’effort, tisser mon imaginaire, douter toujours, sourcer le réel.
La vraie vie ne tient pas dans le clic, mais dans la durée. Dans la vibration du violon, dans l’encre qui sèche, dans le silence d’un regard partagé. Retrouver le souffle, c’est refuser la cadence des machines, revenir à la lenteur des gestes, à la pensée qui s’élabore – et surtout, à l’effort partagé, au doute collectif, à l’erreur assumée. Savoir-faire lents, savoir-être partagés, savoir-penser libres.
Nous ne sommes pas des flux, mais des souffles. Tant que nous pourrons encore respirer, penser, créer lentement, le monde n’est pas un naufrage. Mais pourrons-nous toujours ?
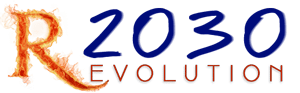

 Comment l’IA nous transforme en primates dociles
Comment l’IA nous transforme en primates dociles